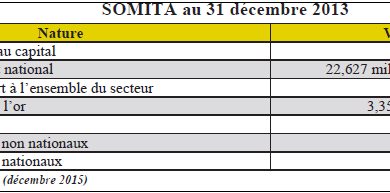Libre regard sur «Les bouts de Bois de Dieu» à l’affiche au CITO

Le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO) propose, depuis le 18 mai, à son affiche «Les bouts de Bois de Dieu» de l’écrivain sénégalais Ousmane Sembène, mis en scène avec la participation de Luca FUSI et d’Aguibou Bougobali Sanou, dans une scénographie d’Issa Ouédraogo.
A l’extinction des feux qui annonce le début du spectacle ou, plutôt, de la randonnée onirique (car c’est bien ce dont il s’agit), le spectateur ne se doute pas encore des secousses émotionnelles qui rythmeront le périple pour lequel il a pris son ticket. Lorsqu’il s’illumine, le plateau nous laisse découvrir un décor sobre traversé à la lisière du lointain par des rails se prolongeant en perspective «côté jardin» et «côté cour». Sur la portion du fond, un léger promontoire conférant à cet espace une ambivalence de niveau bien marquée. Des rails ordinaires, certes, mais investis de la force de suggérer sans équivoque; à la fois le mouvement permanant et la fixité des lieux. Ce procédé prédispose le spectateur à envisager le parcours avec une multiplicité de destinations tout le long de la narration. C’est ainsi que celui-ci se sentira, sans barrière mentale, aussi bien à la gare Naba-Koom (si on le lui suggère) qu’à celle de Sibi, de Dakar, de Bamako… ; si on veut. Magie du théâtre ! Même le don d’ubiquité n’est ici qu’une faculté ordinaire dont use à loisir l’une des interprètes qui est à la fois Adjibidji aujourd’hui livrant son récit et Adjibidji du récit en situation.
Les costumes obéissent eux aussi à la même transformabilité que l’espace qu’ils habitent. Ingénieusement conçus par la jeune et talentueuse Adjara Samandoulougou, ils sont à la base d’un ton neutre évoluant par de simples codes pour marquer chaque personnage de l’histoire. On passera ainsi aisément de masses anonymes dans des circonstances variées (et Dieu sait qu’il y en a à profusion dans ce récit) à une caractérisation claire et lisible des personnages grâce à d’infimes signaux bien pensés. Quant aux accessoires, il n’en existe quasiment pas; la mise en scène a la virtuosité de les faire surgir à l’instant, sous la commande de la situation, pour remplir leur fonction factuelle jugée déterminante et disparaitre ensuite ou se muer en tout autre chose. C’est ainsi qu’un couteau naitra d’un vulgaire bout de bâton pour permettre à Ramatoulaye d’égorger «vendredi»; le mouton de Mabigué. Le mouton lui-même stylisé de sa chair jusqu’aux entrailles que l’on réussit à nous faire voir avec les yeux de l’esprit; ou encore un simple pagne qui devient la vieille Nyakoro lorsqu’elle rend l’âme sous nos yeux. L’instant est si émouvant qu’on oublie que tout cela n’est qu’un jeu, une manipulation vraie du faux; et qui, en fait, est le véritable vrai du théâtre.
L’option qui sous-tend cette création est une vraie leçon de théâtre, un langage clair et simple, mais du genre de simplicité qui ne se trouve qu’au bout de la recherche poussée, de l’exploration artistique féconde; l’art n’émerge-t-il pas là où s’estompe le hasard?
Dans ce concept, le spectateur lui-même participe de la magie: il est placé à dessein pour faire partie des coulisses de l’histoire.
Les émotions brûlent la rampe et arrivent droit au plexus du spectateur sans artifice.
Au détour du traitement de la scène tragique de la mort de l’un des jumeaux de Maimouna, les créateurs de ce spectacle nous donnent la pleine mesure de leur langage scénique. Ici, le sublime se le dispute avec subtil: dans la tourmente des échauffourées, un procédé cinématographique; un travelling optique sans caméra; tout est dans la suggestion, pas dans la monstration; car c’est l’imaginaire du spectateur qui couronne la recette de ce magnifique tour de magie. Dans le sauve-qui-peut généralisé, un bref semblant d’arrêt sur image, un pied écrase ce bébé si menu. Il ne s’agit que d’un bébé factice, un bébé théâtral, mais un frisson vous parcourt la colonne vertébrale et vous comprenez avec votre ventre que l’un des jumeaux de la pauvresse ne répondra plus aux caresses de la mère aimante aveugle. Vous n’y êtes pour rien et, en plus, ce n’est que du théâtre, mais votre intérieur entier est secoué.
Pour ce qui est de la thématique, la polysémie du propos de Sembène nous offre une multiplicité de portes d’entrées dans le récit, car c’est selon l’humeur et la prédisposition mentale du spectateur. Morale sans moralisation, éducative sans aucun didactisme, la plume de Sembène laisse trop peu de place au creux dramaturgique, et l’adaptation de Luis Marquez ne la trahit pas. La trame n’offre pas de héro solitaire, car Sembène savait que, de tout temps, les vraies victoires, les plus significatives aussi, ne se conquièrent qu’ensemble, dans l’effort conjugué avec des principes rigides. A ses yeux, «pour raisonner, il ne s’agit pas d’avoir raison ; mais pour vaincre, il faut avoir raison et ne pas trahir»; et c’est le secret de la réussite de ce combat historique de gens simples contre la redoutable machine des égos cristallisés. Doudou le sait très bien, et c’est pourquoi il ne succombe pas à la tentation des promesses du patronat. Dans cette communauté-là, la trahison fait l’unanimité dans les cœurs : ils la rejettent tous!
Nos bravent cheminots savent également que les grandes victoires se consomment avec modestie, ils ne clament pas la leur sur les toits, tambours battants. Lorsque tant de sacrifices a été consenti individuellement et collectivement, la victoire ne contient-elle pas un zest d’amertume dans sa saveur ? Nous ne parlerons pas ici d’une victoire à la Pyrrhus, mais, tout de même, un léger voile de nostalgie recouvre l’azur.
La haine, elle aussi, est proscrite chez ses petits bouts de bois de Dieu: à sa libération, le vieux Fa Keita, longtemps embastillé et torturé, ne réclame ni le sang ni les larmes de ses bourreaux. «Lorsque le combat est terminé, il faut savoir laver les esprits de la haine», dit-il à ses compairs. Rien d’étonnant pour des gens qui ont la hauteur d’esprit de ne pas penser le monde à partir du conjoncturel, mais dans une globalité humaniste et historique. Chez eux, il y a plus de noblesse à échouer dans la tentative de construire qu’à réussir la destruction de l’idéal commun. Ni les chantages, ni les menaces n’ont d’effets sur leur détermination; même si, en face, on espère que leur idéal s’émousse à l’usure du temps et des ventres qui se creusent davantage chaque jour.
Les interprètes de ce spectacle ne sont pas en reste. Loin s’en faut! Ils sont vrais et crédibles dans l’essentiel des situations. Au fil du tracas partagé, les visages et les corps empreints d’une gravité troublante voyagent dans l’univers sonore renversant de Roger Wango. Ces corps, magnifiquement éclairés par les ambiances féériques créées d’une main de maitre par Amado Sawadogo, guident le spectateur dans son parcours du labyrinthe intérieur des personnages qu’ils incarnent. Toutes choses qui contribuent à insuffler au spectacle un rythme palpitant et à lui conférer la faculté démiurge de rendre le temps extensible et compressible à volonté. Dans ce traitement, la musique et la danse ne sont pas des plages extra-conçues à l’effet de divertir platement ou de combler quelque manque. Elles sont partie intégrante du caractère organique du spectacle. Une randonnée palpitante malgré de légers relâchements de la tension dramatique observés chez certains interprètes sur la courbe finissante, ainsi que quelques rendez-vous techniques bégayants par endroits.
Bravo à toute l’équipe, et rendez-vous au suivant de ces épisodes!
Sita Fofana et Rakiéta Kanazoé, les grandes révélations
La grande révélation de cette création aura été d’un côté Sita Fofana qui a créé une vieille Nyakoro troublante dans ses moindres gestes, crédible et touchante à tout point de vue (rien d’étonnant pour une comédienne qui transfuge de l’école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané) et, de l’autre, la jeune Rakiéta Kanazoé jusque-là méconnue des planches. Elle se revêt ici, comme d’un gant, de la peau et des ressources intérieures de la petite Adjibidji. Voici une comédienne en devenir qui mérite d’être accompagnée afin de lui donner des chances d’aiguiser son talent brut.
Ce spectacle est une grande œuvre qu’il faut compter au nombre des pépites du CITO. Il n’est pas sans rappeler d’autres lauriers du théâtre burkinabè dont la fierté habite encore nos publics: La Tribut, sous la direction de Louis Gonzagué, Yennenga de Felix Boyarm, Le Gouverneur de la rosée, créé par Prosper Kompaoré ou encore La musaraigne de Jean-Pierre Guingané, pour ne citer que ceux-ci.
Le spectacle «Les bouts des Bois de dieu» reste à l’affiche du CITO, du mercredi au samedi, jusqu’au 9 juin; une véritable nourriture de l’âme et de l’esprit; recommandable à toutes les conditions et à toutes les générations et à consommer sans modération.