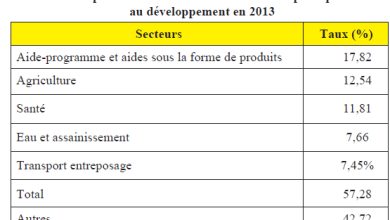Il n’y a pas d’endettement gratuit

CAMBRIDGE – Pendant plus d’une décennie, nombre d’économistes – essentiellement, mais pas toujours de gauche – estimaient que les avantages du recours à l’endettement pour financer les dépenses publiques l’emportaient largement sur les coûts associés. L’idée même que les pays avancés puissent souffrir de surendettement était largement rejetée, et les voix critiques souvent moquées. Même le FMI, partisan habituel de la prudence budgétaire, commençait à défendre les plans de soutien financés essentiellement par l’endettement.
Mais le vent a tourné au cours des deux dernières années, ce type de pensée magique étant brutalement confronté à la dure réalité d’une inflation élevée et au retour des taux d’intérêt à long terme à leur niveau normal. Publiée récemment par trois économistes seniors du FMI, une nouvelle évaluation des risques de l’endettement souligne ce basculement remarquable. Selon l’estimation des auteurs, du fait de la médiocrité de leur perspective de croissance à long terme, le ratio moyen dette/PIB des pays avancés va augmenter de 120% d’ici 2028. Ils soulignent également que le coût élevé du crédit devenant la «nouvelle normalité», les pays développés doivent «reconstruire de manière crédible et progressive leur réserve budgétaire et veiller à la solvabilité de leur dette souveraine».
Cette évaluation équilibrée et mesurée est loin d’être alarmiste. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, toute suggestion de prudence budgétaire était rapidement rejetée en tant qu’austérité par une grande partie de la gauche. Ainsi, on trouve 102 fois le mot «austérité» dans un livre d’Adam Tooze paru en 2018, portant sur la crise financière mondiale de 2008-2009 et ses conséquences.
Jusqu’à très récemment, l’idée que le surendettement de l’Etat pose problème était presque taboue. En août dernier, Barry Eichengreen et Serkan Arslanalp ont présenté un excellent article sur la dette mondiale, lors de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Ils y mettaient en évidence le niveau extraordinaire de la dette publique accumulée, après la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19. Mais curieusement, ils n’expliquent pas clairement en quoi cela pourrait poser un problème aux pays avancés.
Ce n’est pas seulement une question de comptabilité. S’il est vrai que les pays développés font rarement formellement défaut sur leur dette intérieure (en recourant souvent à des tactiques telles que l’inflation surprise et la règlementation financière pour gérer leur passif), il n’en reste pas moins que le surendettement est préjudiciable à la croissance. Carmen M. Reinhart et moi-même avons développé cette idée dans un court article, en 2010, et dans une analyse plus complète coécrite avec Vincent Reinhart en 2012. Ces articles ont suscité un débat animé, souvent entaché de déformations flagrantes, parfois liées à la confusion entre financement par le déficit (qui peut temporairement stimuler la croissance) et surendettement (qui tend à avoir des conséquences négatives à long terme). Les économistes universitaires s’accordent largement sur le fait que le surendettement peut entraver la croissance en décourageant l’investissement privé et en réduisant la marge de manœuvre budgétaire, lors des récessions les plus graves ou de crises financières.
Certes, avant la pandémie, lorsque les taux d’intérêt réels étaient très bas, l’endettement permettait, semblait-il, de dépenser sur-le-champ sans avoir à payer plus tard. Mais cette frénésie de dépenses reposait sur deux hypothèses:
– Les taux d’intérêt appliqués à la dette souveraine resteraient indéfiniment bas ou augmenteraient si lentement qu’un pays disposerait de décennies pour s›y adapter.
– Des besoins de dépense soudains et massifs (par exemple, un renforcement militaire en réponse à une agression étrangère) pouvaient être financés par encore plus d’endettement.
A considérer le boom économique des USA, à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait croire qu’un pays peut sortir du surendettement simplement par la croissance. Un récent article de deux économistes, Julien Acalin et Laurence M. Ball, réfute cet argument. Il montre que sans le contrôle strict des taux d’intérêt aux USA, après la Deuxième Guerre mondiale et des poussées inflationnistes périodiques, leur ratio dette/PIB aurait atteint 74% en 1974, alors qu’il n’a été que de 23%. Mais dans l’environnement économique d’aujourd’hui marqué par des objectifs en matière d’inflation et des marchés financiers mondiaux bien plus ouverts, cette tactique n’est sans doute guère plus applicable, car elle nécessiterait des changements majeurs dans la politique budgétaire américaine.o
Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz
Copyright: Project Syndicate, 2024.
www.project-syndicate.org
Par Kenneth Rogoff
Encadré
L’endettement a toujours eu un prix
Soyons équitable : il n’y a pas de raison de paniquer, au vu de la dette publique, au moins dans les pays avancés. Des pics d’inflation occasionnels ou des périodes relativement longues d’intervention de l’Etat n’ont rien de catastrophique. Il faut cependant souligner que si les citoyens les plus riches peuvent recourir à tout un éventail d’investissements qui leur permettent d’amortir l’impact d’une réforme budgétaire, ce sont, en général, les ménages à revenu faible ou moyen qui en paient le prix.
Autrement dit, la dette publique peut être un instrument précieux pour répondre à une myriade de problèmes économiques, mais l’endettement a – et a toujours eu – un prix.