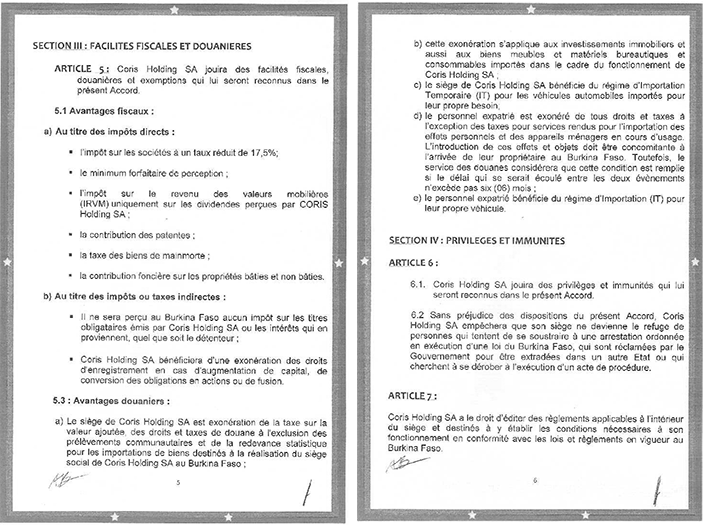Alif Naaba au Café de L’Economiste du Faso: So wok: bien sûr, le chemin a été long


C’est le premier artiste musicien et non des moindres que le Café de L’Economiste du Faso reçoit à l’occasion de la sortie de son album So wok qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Une rencontre qui a permis de découvrir de nombreuses facettes d’Alif Naaba pour ses lecteurs. Derrière l’artiste, se cache un homme aux idées novatrices, un entrepreneur qui a lancé les Rencontres musicales africaines de Ouaga et dont L’Economiste du Faso était partenaire lors de la première édition. La deuxième édition est encore en préparation.
Sept ans entre le dernier album et « SO WOK », le chemin était vraiment long ?
Bien sûr, le chemin a été assez long. Il nous a fallu 7 ans pour que l’album sorte enfin. Ça a été un chemin périlleux. Pour moi, 7 ans c’est long mais il faut bien faire les choses.
7 ans entre deux albums, pendant ce temps, viviez-vous de quoi ?
Ce n’est pas un chronogramme que je me suis imposé. C’est plutôt les choses qui se sont imposées. J’ai fait le tour du monde avec mon album « Yiki ». J’ai vu beaucoup de choses et j’ai pensé les organiser chez moi au pays. J’ai mis en place à Ouagadougou, notamment, les Rencontres musicales africaines (REMA) et un lieu de résidence artistique pour les musiciens. J’ai organisé mon label, « La cour du Naaba », qui produit aujourd’hui des artistes, notamment, Nabalüm. On s’est lancé dans le Booking. On s’est occupé d’un groupe français en Afrique avec qui j’ai collaboré en France, à savoir le groupe DUB INC. On a fait une tournée avec ce groupe dans une dizaine de pays africains. Ces activités ont pris beaucoup de temps. Je n’étais pas assis, je travaillais. Vous savez, la musique ne se limite pas seulement à sortir un album. Derrière, il y a beaucoup de maillons où on peut se faire de l’argent. Il y a l’argent dans la production, dans le Booking, dans le placement des artistes, dans l’édition, dans le prêt d’image, etc. Le Coronavirus a aussi impacté sur notre programme. L’album devait sortir il y a 2 ans.
Quel retour avez-vous personnellement des mélomanes?
Avant la sortie de l’album, nous avons organisé des écoutes privées avec des presses spécialisées. Nous l’avons fait avec quelques presses spécialisées africaines, notamment, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Congo et le Sénégal. On a eu des retours avant la sortie de l’album. Le retour du citoyen lambda, du fan nous montre que le résultat du travail des journalistes spécialisés était vrai. C’est 7 ans de travail pendant lesquels on a capitalisé l’émotion des gens, mis sur bande sonore les histoires des vécues des gens. Quand un tel album a l’assentiment des fans ou de ceux qui nous découvrent nouvellement, ça nous fait plaisir. On a donc les mêmes retours aussi bien chez les professionnels que chez les fans.
Alif s’est donc investi sur les autres maillons de la musique. Pourquoi revenir encore devant la scène ?
Je n’avais pas abandonné. C’est la réalisation de ces choses qui a pris du temps. Il fallait impliquer d’autres personnes dans ces projets. Aujourd’hui, même si je suis toujours impliqué, les REMA sont pilotées carrément par des gens. C’est le cas pour la production. A ce niveau, on arrive à s’organiser. Au départ, j’étais personnellement impliqué, parce qu’il fallait impulser les choses. Je crois que maintenant, je suis très productif.
La sortie de cet album n’est-elle pas pour vous plus du marketing ?
C’est le tout. Premièrement, je partage ma vision du monde dans ce que je sais faire qui est la musique. J’ai 15 ans de carrière dans ce métier. Deuxièmement, maintenant, je ne fais pas de la musique pour me faire voir, mais pour faire du business. Le problème des musiciens de nos jours est qu’ils ne parlent pas de business, ils ne parlent pas de chiffres. Pour attirer les investisseurs dans un domaine, il faut leur donner des chiffres pour qu’ils sachent que le secteur est rentable. C’est l’une des raisons de la mise en place des REMA avec 3 jours d’échanges autour de l’économie de la musique. Je parle business avec mon album. Il y a tout un processus de communication commerciale autour de l’album. Par exemple, on sait combien de CD on vend, combien on gagne sur chaque CD. On peut faire le point sur la rentabilité de « So wok ». Oui, je fais aussi du business, mais ça ne doit pas tuer l’art. Les artistes comme Youssou N’Dour sont des artistes qui ont traversé toutes les générations, car ils ont compris que la musique, c’est l’artistique mais aussi du business.
La conception d’un tel album et sa promotion représentent combien en termes d’investissement ? Avez-vous reçu un soutien de la part du ministère de la Culture ?
Sur les albums, non. On ne travaille pas avec le ministère, c’est un business personnel. Le ministère nous accompagne sur les REMA, sur les projets à caractère public.
Aujourd’hui, c’est difficile d’arrêter un chiffre, car nous sommes en pleine production. Mais du début jusqu’à la fin de production de l’album, on était à un chiffre qui tourne dans une fourchette entre 15 et 20 millions.
Avec la digitalisation, on ne consomme plus le CD. Comment vous vous en sortez ?
On s’adapte. D’ailleurs, les REMA s’inscrivent dans ce cadre. On est sur un axe très digital. On veut une adaptation des gens à la digitalisation. Etant initiateur des REMA, j’ai l’obligation d’être à la pointe des choses. L’album « So wok » est l’un des albums les plus mis en avant sur les plateformes. Nous avons un bon distributeur avec lequel nous avons mis en place des stratégies. L’album se trouve sur beaucoup de plateformes. On ne se plaint pas sur ce côté. Notre distributeur s’appelle « Wise band » et le site c’est : www.wiseband.com. Beaucoup d’artistes n’ont pas la chance que nous avons. Ils passent par d’autres structures. Nous avons la chance d’avoir un distributeur avec qui on peut causer, on peut prendre des avances, car nous vendons les disques en ligne. Le CD n’est plus comme avant mais ça se consomme aussi. Il est devenu un produit marchandising. Nous avons mis en place un système appelé les journées ventes-dédicace où nous rencontrons beaucoup de monde et nous vendons beaucoup de CD. Il y a des fans qui veulent un CD avec dédicace accompagné d’un tee-shirt. Ça, c’est du marchandising, c’est comme un produit de luxe. Pendant cette journée, on rencontre les fans pour renforcer les relations ; mais derrière, c’est du business. Ça crée du boulot pour les gens qui sont autour de toi. En Europe, il y a longtemps les gens ont compris que les CD font partie des produits marchandising. Quand ils viennent en concert, ils veulent en partant, acheter un article de l’artiste. Tout cela, pour dire que le digital est là, il est incontournable et il faut s’adapter.
Face à la digitalisation et au piratage, des artistes comptent sur les concerts pour rentabiliser. Quels est votre modèle économique ? Comment rentabilisez-vous ?
Effectivement, beaucoup d’artistes le font. Je critique cela pas en tant que Alif Naaba mais en tant qu’initiateur des REMA. Les deux peuvent aller ensemble. Il y a des gens qui n’ont pas les moyens pour s’offrir un CD. Quand un artiste sort un album, nous pensons qu’il faut mettre sa musique à disposition sur certaines plateformes mais aussi le vendre. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes burkinabè sortent des œuvres de qualité, mais les mettent malheureusement sur Youtube. Pour eux, le volet vente ne les intéresse pas. Ils veulent les rendre seulement disponibles gratuitement pour être appelés dans les concerts. C’est vrai, les concerts font gagner beaucoup d’argent, mais il faut aussi mettre son œuvre sur les plateformes de vente. L’un ne gêne pas l’autre, ce sont des niches en plus. Mais les concerts restent les premiers moyens pour se faire de l’argent.
Vous êtes l’un des artistes qui tournent le plus en dehors du Burkina Faso. Jusqu’où comptez-vous porter ce 5e album ?
On a pensé à tous nos publics. Nous avons des publics un peu partout dans le monde. Pour cet album, nous avons décidé de faire sa promotion ici d’abord, avant d’aller dans la sous-région et dans le reste du monde. La promotion consistera à la présentation de l’album, à des concerts, des rencontres avec des publics pour mieux découvrir l’album en version live. On développera de nouvelles stratégies autour de cette promotion pour pouvoir écouler le disque et les produits assimilés, notamment, le tee-shirt.
On dit souvent que le public burkinabè est l’un des publics exigeants en matière de musique. Etes-vous d’avis ?
Non, je ne suis pas d’accord. C’est une parole qu’on dit. Je crois que c’est un public dans lequel il y a des gens exigeants. C’est comme tous les publics du monde. On a vu des œuvres, je suis désolé de le dire, mais en tant qu’artiste, ce n’est pas normal. Il y a aussi des gens qui sont exigeants, qui veulent des œuvres de qualité. Je ne fais aucune exception. Tous les publics sont pareils. Même aux Etats-Unis, il y a des œuvres qui sont décourageantes mais ça marche, ça plaît.
Vous avez fait des collaborations avec Smarty du Burkina, Ismaël Lo du Sénégal et Djam d’Algérie. Pourquoi ces artistes ? Avez-vous des anecdotes à nous raconter ?
Effectivement, il y a beaucoup de collaborations sur l’album avec des artistes de cœur. Ismaël Lo a bercé ma vie artistique. Quand j’étais petit, je chantonnais ses chansons. C’est un gros rêve que je réalise. Lors de ma première tournée en Europe, je l’ai rencontré. Nous avons joué sa première partie. Ce jour-là, après la prestation, il est venu me voir en coulisse pour me féliciter. On a gardé contact. En 2015, le FESPACO m’avait demandé de proposer un artiste pour la cérémonie d’ouverture. J’avais proposé Ismaël Lo. Après l’évènement, notre relation s’est renforcée. Nous sommes devenus plus proches. Depuis lors, on a commencé à parler de collaboration. C’est ainsi que j’ai réalisé « mdawa » avec lui. Pour moi, c’est une icône très immense de la musique africaine. J’ai fait aussi une collaboration avec Smarty. Pour moi, c’est le rappeur contemporain de l’Afrique. Il écrit des textes depuis pratiquement 20 ans qui ont nourri la vie de beaucoup ici. Il fait partie du quotidien des Burkinabè. Ces textes révèlent des choses qu’on aime ou pas. C’est un artiste aux talents énormes. Il a du goût. J’aime bien travailler avec des artistes qui ont du goût et qui ont une démarche professionnelle. Smarty est différent. Je le suis aussi, donc j’aime être avec des gens différents. J’ai pensé que c’est lui qui pouvait trouver les mots qu’il faut pour encourager les orphelins, leur donner de la force. Dans cette belle chanson « Kiiba », vous voyez comment Smarty dévoile son cœur pour donner de la force. C’est pareil pour Djam qui est un artiste que j’ai rencontré dans mes tournées. On a joué dans la salle El ouga en Algérie. J’ai travaillé par la suite avec lui et je l’ai également rencontré un peu partout dans le monde. Il est devenu un ami avec qui on se parle. Dans ma démarche artistique, la zone d’Algérie, du Maroc m’intéresse. Derrière la connexion featuring, il y a l’aspect marché, vision d’élargissement de la « fan base. C’est un artiste très suivi. Il a 300.000 followers sur Instagram. Pour moi, c’est une collaboration aussi bien, parce que j’aime l’artiste, il chante très bien mais aussi j’ai envie d’entrer dans ce marché. J’ai fait aussi une rencontre avec Pessi qui est un jeune arrangeur que j’adore artistiquement. J’ai collaboré avec lui sur la chanson « good to know ». Cet album est aussi un album de rencontre. Je partage des chansons avec des différents publics. Les gens ont aimé les chansons et ils demandent le clip. Ces collaborations vont apporter leur petit plus à l’album « So Wok ».
Etes-vous à un tournant stratégique dans votre carrière ?
J’essaie de mettre en pratique ce que j’ai appris sur ces dernières années. J’ai participé à des Salons, des marchés de la musique. J’ai été paneliste dans des Salons au niveau international. J’apprends de l’industrie de la musique. Donc, j’essaie de mettre en pratique ce que j’ai appris pendant toutes ces années.
Quelles ont été les grandes salles dans lesquelles vous avez joué et quel est le public qui vous a plus émerveillé ?
J’ai vu des choses qui m’ont surpris. Parmi elles, il y a ma tournée en Asie. C’était la première fois dans certains pays, notamment, en Indonésie, aux Îles Brunei et au Laos que les gens voient un artiste africain. Nous avons été les premiers africains à aller jouer là-bas. J’ai été vraiment étonné. J’ai fait 4 concerts dans 4 villes différentes en Indonésie. Il y a une ville qui s’appelle Surabaya qui m’a beaucoup marqué, car on avait beaucoup de monde. Ce sont des choses incroyables. Après, c’était le Brunei qui a été extraordinaire. C’est un pays très surveillé. Pour faire un concert, il faut d’abord avoir l’autorisation d’un comité de censure qui vient assister au concert. Ce comité peut censurer ton concert s’il parle de politique ou de religion. En plus, c’était interdit de jouer très fort avec la sono. Malgré toutes ces contraintes, nous avons réussi à relever le défi. A la fin du concert, nos CD ont manqué, car ils ont tous été achetés. Ce sont des histoires qui m’ont beaucoup marqué. Il y a aussi des concerts en Europe qui m’ont marqué, notamment, le concert à Chambéry en 2017, devant 24.000 personnes, et celui du Zénith de Saint Etienne que j’ai fait avec le groupe DUB INCORPORATION. C’était énorme, c’étaient des moments fous.
La Rédaction