Albert G Zeufack : «Les fonds IDA sont précieux !»
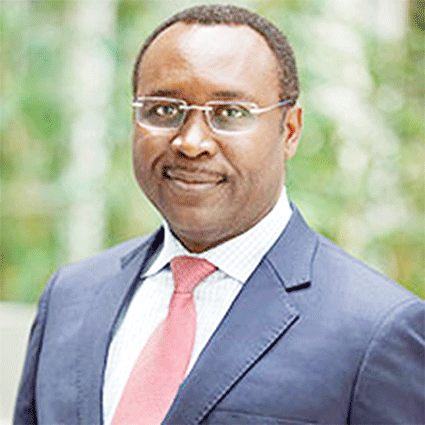
Albert G. Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, a séjourné au Burkina à l’occasion du lancement du rapport CPIA 2016. L’Economiste du Faso a pu le rencontrer dans les locaux de la banque à Ouagadougou, pour échanger sur le rôle du classement CPIA pour le gouvernement. Il se prononce également sur le dividende démographique, question d’actualité au Burkina, avec la tenue d’une rencontre des parlementaires de la CEDEAO.
L’Economiste du Faso: Comment se passe votre séjour au pays des Hommes intègres ?
Albert G. Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique: Je suis très heureux d’être au Burkina Faso. Pour les gens de ma génération, le Burkina Faso représente le pays de l’espoir, le pays de Thomas Sankara qui était notre héros quand nous étions tous à l’université. C’est un pays qui a su constamment relever les défis de son temps. Donc, je suis très heureux que le Burkina ait été choisi pour le lancement du rapport CPIA ou EPI en français, sur l’évaluation des politiques et des institutions. Ce n’est pas ma première visite au Burkina Faso. Par rapport à la dernière fois, je constate beaucoup de changements.
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé, 10 ans après votre première visite ?
La dernière fois que j’étais là, il n’y avait pas Ouaga 2000. Et je crois qu’on m’a logé dans cette zone expressément pour me permettre de découvrir cette nouvelle cité. Elle est assez impressionnante et donne toute les allures d’une ville moderne, planifiée, où il n’y a pas d’habitats spontanés et des bidons villes qu’on voit ailleurs.
Il y a également une infrastructure qui est planifiée pour accueillir une population grandissante. C’est une des choses qui manquent à nos villes africaines, à savoir que le développement urbain s’est fait de façon chaotique et a entrainé une congestion qui a un coût économique énorme.
Le futur, c’est de voir comment amener nos pays à concevoir des cadres urbains plus fonctionnels, plus connectés. La connectivité, ici, ce n’est pas seulement l’infrastructure, c’est de connecter l’homme à son lieu de travail, de permettre une circulation des ressources qui optimise le temps. La Banque mondiale a produit un rapport régional sur l’urbanisation en Afrique qui parle des problèmes de connectivité, de congestion, mais aussi et surtout des coûts induits par la congestion qui font que nos villes sont plus chères par rapport au revenu des habitants, quand on les compare aux autres villes du monde.
Nos villes, plutôt que d’être des creusets de l’innovation et d’emplois productifs, constituent des freins à l’éclosion du secteur privé. Ces questions d’urbanisation sont importantes et devraient faire partie de toute logique de transformation structurelle de nos pays.
A quoi se résume le poste d’économiste en chef pour la région Afrique ?
Le titre d’économiste en chef est assez spécial dans notre institution qu’est la Banque mondiale. Nous avons près de 12.000 staffs à travers le monde. Mais, dans tout le groupe, il n’y a que 15 économistes en chef. La banque a 6 régions géographiques, avec un économiste en chef par secteur d’activités et par groupe d’activités: développement soutenable, le capital humain, institutions et gouvernance. Et chaque institution du groupe de la Banque mondiale a un économiste en chef ; et nous sommes tous coiffés par un économiste en chef pour tout le groupe de la Banque mondiale qui est actuellement le Pr Paul Romer, l’inventeur de la théorie de la croissance endogène.
Le travail de l’économiste en chef régional consiste en deux choses. Premièrement, produire des travaux analytiques ou des études de qualité qui permettent d’en tirer des recommandations pertinentes pour les politiques économiques des pays de la région, afin que nos opérations soient bâties sur du solide.
Deuxièmement, disséminer le travail de connaissances qui est généré dans la région, donc travailler avec les gouvernements, les institutions universitaires, les réseaux d’universitaires, pour s’assurer que la connaissance produite est mise à la disposition des autorités et du grand public. C’est pour cette raison que lorsque j’effectue une visite dans un pays, je me fais le devoir de donner une conférence dans les universités pour échanger sur les méthodes et les outils, mais aussi sur les résultats de nos études.
Au-delà de tout, l’économiste en chef est le conseiller du vice-président de la région. C’est le conseiller du président du groupe de la Banque mondiale.
Le réseau d’économistes en chef rencontre régulièrement le président du groupe, chaque fois que de besoin. Nous sommes également les conseillers de nos collègues qui gèrent les opérations de la banque.
Qui définit les grandes orientations d’une région ?
Elles sont définies par le vice-président. Ce que nous faisons, c’est de donner le contenu analytique qui soutient ces orientations.
Vous êtes à Ouagadougou pour le lancement du rapport sur l’évaluation des politiques et des institutions. Pourquoi vouloir classer les pays selon la gouvernance ?
C’est une excellente question, parce que la Banque mondiale s’organise pour octroyer aux pays à faibles revenus des financements concessionnels pour leur développement. C’est-à-dire que le guichet IDA octroie des dons et des prêts à des taux extrêmement subventionnés, avec des durées de paiement extrêmement longues, qui permettent aux pays de financer leur développement.
Dans le financement d’une route, des infrastructures de santé ou d’un aéroport, on sait que le retour n’est pas immédiat. Le pays a donc besoin de ressources longues et moins cher, si on ne veut pas arriver à un stade où la dette devient non soutenable. Ces ressources concessionnelles sont précieuses, et il nous faut un outil pour les allouer.
Nous nous basons donc sur la performance des pays. On sait que si on continue de donner de telles ressources à des pays qui ne les utilisent pas bien, nous ne faisons pas œuvre utile. Il est donc important de regarder les types de politiques mis en œuvre par les pays et susceptibles d’entrainer une croissance soutenue, les pays qui sont en tain de mettre en place des politiques inclusives qui luttent contre l’inégalité, les pays qui mettent en place des réformes au niveau de la gouvernance et de la transparence.
Voilà ce qui nous motive dans l’élaboration de l’EPI. Nous analysons la qualité des réformes et des institutions chargées de la mise en œuvre de ces réformes. Par exemple, si un pays dit qu’il combat la corruption, le fait de mettre en place une agence indépendante dédiée à cela est un signe de sérieux. Mais si cette agence est mise en place et qu’elle n’a aucun pouvoir, c’est aussi un signe que le pays n’est pas aussi sérieux que cela.
Nous prenons tout cela en compte dans l’évaluation de la qualité des politiques et des institutions pour les notations. Ce sont ces notes qui permettent d’attribuer un volume de fonds à un pays. Je peux vous dire que ces fonds ne sont pas réservés qu’aux pays africains. 77 pays dans le monde sont concernés, dont 39 en Afrique subsaharienne. Il y a donc une compétition entre les pays, avec des critères stricts et transparents d’allocation des fonds.
La note CPIA rentre en ligne de compte pour la détermination de l’enveloppe pays à allouer. Il est extrêmement important pour les pays de comprendre cela et de travailler à améliorer les politiques, parce que nous faisons le monitoring pour nous assurer plus de ressources pour leur développement. Il y a un deuxième aspect de cette notation sur lequel je souhaite insister. Au-delà de l’enveloppe, la notation doit être un outil de conception, de suivi, voire un outil de coordination des politiques mises en œuvre, notamment pour les quatre blocs de politiques que nous suivons.
Le Burkina stagne dans le classement. Ce n’est pas bon signe…
Le Burkina est à 3,6 points comme l’année dernière. Ce qui n’est pas mauvais. Mais il est en léger recul par rapport à son score d’il y a deux ans. Il y a trois ans, le pays était 3,8 points. Cela peut s’expliquer par les perturbations qu’a connues le pays. Mais le plus important, c’est que l’opportunité du lancement du rapport ici à Ouagadougou a permis au Premier ministre et aux membres de son gouvernement de s’accorder sur la nécessité de travailler pour que le Burkina retrouve très rapidement cette notation de 3,8 points .
Ce rapport suscite-t-il autant d’engouement auprès des gouvernements que le rapport Doing Business?
Les indicateurs Doing Business sont réduits à 10, seulement pour évaluer l’environnement des affaires, et ils contribuent à un seul pilier de l’EPI. En fait, ce qui m’amène à renforcer cet aspect de l’EPI comme outil de coordination et de suivi des politiques, c’est en regardant l’exemple du rapport Doing Busines où les pays se sont mobilisés quand ils ont compris combien il était important d’améliorer l’environnement des affaires. Si on pouvait répliquer le même processus et le maintenir dans la durée pour l’EPI, cela entrainerait un impact plus important sur la croissance, parce que l’EPI est beaucoup est plus compréhensif.
Comment y arriver alors?
Il faut expliquer et partager les informations ; discuter avec les gouvernements. C’est ce que nous avons fait au Burkina. Les ministres en charge de l’Economie comprennent vite les enjeux, mais pas tous les autres ministres. Lors de mon séjour, on eu l’occasion d’échanger avec une demie douzaine de ministres sur le sujet, et le Premier ministre est partant pour la mise en place d’un comité de suivi. Et comme le Burkina est un pays très sérieux, nous espérons travailler avec le gouvernement pour arriver à de bons résultats.
Il est de plus en plus question de capturer le dividende démographique. Comment la maîtrise-t-on ?
La question de la démographie est importante, mais ne doit pas être traitée sous l’angle de la polémique. Nos études montrent que la démographie peut aussi bien être un atout qu’un inconvénient. Il est important de garder la tête froide et de regarder la question de façon factuelle.
Plus de 50% de la population africaine ont moins de 25 ans. Le défi de création d’emplois est énorme. Mais si cette population est éduquée, munie d’outils pour se créer son propre emploi, si l’environnement des affaires est propice au développement du secteur privé, cela devient un véritable atout.
Dans un rapport sur le croît démographique, nous concluons que tout dépend des politiques mises en place dans les pays. Le plus important est de se demander quels sont les facteurs qui conduisent à la baisse du taux de fécondité dans le temps. Ces facteurs sont connus. C’est premièrement l’éducation des femmes. Plus elles sont éduquées, moins elles font des enfants. Le deuxième facteur est la participation des femmes au marché de l’emploi et le troisième facteur est l’urbanisation.
Il n’est pas étonnant de constater que les pays où le taux de fécondité est élevé soient également ceux où la proportion de la population vivant en zone rurale est la plus élevée. Les économistes doivent se saisir de ce débat pour apporter des faits, qu’ils ne restent pas uniquement dans l’arène du pugilat politique. Le croît démographique peut être un atout, si on a des économies capables de transformer cette jeunesse en opportunité, en un pilier de développement.
Pour la majorité de nos pays, c’est loin d’être le cas…
Tout à fait ! C’est pour cela que nous devons réfléchir froidement et envisager les mesures qui permettent de façon saine d’arriver à des taux de fécondité qui supportent notre croissance.
En clair, ne s’agit-il pas de dire de diminuer le taux de natalité ?
J’ai dit plus haut que ce débat doit être mené à l’aune des faits, et que l’on doit cesser de donner des leçons. Il ne s’agit pas d’imposer des modes culturels. Ramenons le problème à l’économie. On n’a pas besoin que quelqu’un d’autre pose ces questions à notre place.
Si on pense à la croissance, si on pense à éradiquer durablement la pauvreté, on ne peut pas ne pas discuter du croît démographique. Comment allons-nous transformer ce croît démographique en opportunité de croissance ? Comment éduquer cette jeunesse ? Comment l’équiper d’outils pour qu’elle profite de cette révolution technologique en cours et où l’Afrique est encore à la peine ?
La bande passante, qui est aujourd’hui un fait de vie, peine à se développer. Nous devons mettre l’accent sur ces infrastructures physiques et virtuelles qui seront le moteur de la croissance du futur. Au Kenya, le boom technologique à générer un secteur nouveau. Avec le Mpessa, le taux de pénétration du téléphone est pratiquement de 99%, avec la monnaie électronique. Le taux d’accès au secteur financier a, par conséquent, explosé. Trois choses ont permis cela : l’adoption de la technologie qui a permis de contourner les obstacles (des lignes fixes), la mise en place de bonnes politiques et la position déterminante du secteur privé.
Propos recueillis par AT
Albert G. Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique
Albert G. Zeufack est depuis mai 2016 l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique. Avant d’être nommé à ce poste, il était directeur au pôle mondial d’expertise en macroéconomie et des finances publiques et chef de file d’une communauté d’experts de la Banque mondiale sur les économies de rente. Son domaine principal de recherches porte sur les fondements microéconomiques de la macroéconomie.
Albert Zeufack est rentré à la Banque mondiale dans le cadre du programme de recrutement de «jeunes professionnels» en 1997 et a commencé sa carrière comme chercheur au sein de la Division macroéconomie et croissance du département de la recherche. Il a ensuite occupé différents postes au sein des régions Afrique, Asie de l’Est et Pacifique, et Europe et Asie Centrale. Entre 2008 et 2012, il s’est mis en disponibilité pour travailler dans le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional Berhad, en tant qu’économiste en chef et directeur de la recherche et de la stratégie.
De nationalité camerounaise, Albert Zeufack est titulaire d’un doctorat en sciences économiques du CERDI-Université de Clermont-Ferrand (France) où il a enseigné avant de rejoindre la Banque mondiale. Il est également titulaire d’un DEA en analyse et politiques économiques de l’Université de Yaoundé (Cameroun), et a suivi des enseignements professionnels à Harvard et Stanford. Albert Zeufack est membre du réseau de l’ONU pour le développement durable, membre du comité technique consultatif pour la Charte des ressources naturelles (Oxford), membre du conseil consultatif de l’Institut pour la gouvernance des ressources naturelles (NRGI) et membre du conseil d’administration du Consortium pour la recherche économique en Afrique (AERC).
Source : Banque mondiale





