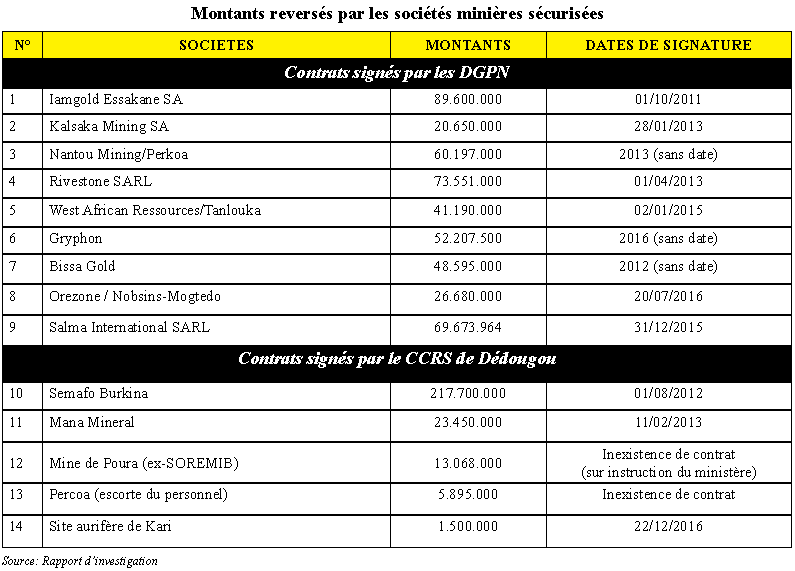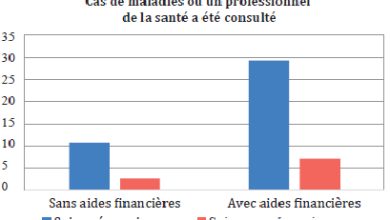Plus de guerre que de paix – Par John Andrews

WINCHESTER – «Seuls les morts ont vu la fin de la guerre». L’apophtegme de George Santayana semble particulièrement convenir à la période que nous vivons, où le monde arabe, de la Syrie à l’Irak et du Yémen à la Libye n’est plus qu’un chaudron de violence, où l’Afghanistan s’enlise dans la lutte contre les talibans, où des pans entiers de l’Afrique semblent voués à la malédiction d’affrontements sanguinaires, qui recoupent souvent des divisions ethniques ou religieuses, pour le contrôle des ressources minières. La tranquillité européenne elle-même est en péril, témoin le conflit séparatiste en Ukraine, qui, avant le cessez-le-feu actuellement en vigueur, a fait six mille morts.
Comment expliquer ce recours au conflit armé pour résoudre les problèmes du monde ? Il n’y a pas si longtemps, la tendance était à la paix, pas à la guerre. En 1989, avec l’effondrement du communisme, Francis Fukuyama annonçait la «fin de l’histoire », tandis que deux ans plus tard, le président George Bush père saluait le «nouvel ordre mondial» de la coopération entre grandes puissances.
À l’époque, ils avaient raison. La Seconde Guerre mondiale et ses 55 millions de morts avaient marqué le point culminant de la barbarie collective de l’humanité. Mais de 1950 à 1989 – de la guerre de Corée à la fin de la guerre froide, en passant par la guerre du Viêt-Nam –, les conflits armés causèrent en moyenne 180.000 morts par an. Dans les années quatre-vingt-dix, leur nombre est tombé à 100.000.
Et dans la première décennie de ce siècle, il a encore diminué, pour atteindre une moyenne de 55.000 morts par an – le taux le plus bas enregistré sur une décennie au cours des cent dernières années, qui représente un peu plus de 1.000 morts annuels pour un «conflit armé moyen».
Malheureusement, comme je m’en suis déjà fait l’écho dans mon dernier livre, The World in Conflict, la tendance est aujourd’hui en train de s’inverser. Si l’on considère que nombre de guerres africaines, de la République démocratique du Congo à la Somalie, durent depuis plusieurs décennies, l’explication de ce renversement réside ailleurs: dans le monde musulman, depuis le nord du Nigeria à l’Afghanistan et au-delà.
Le nombre de tués dans la guerre civile syrienne, qui a éclaté en 2011, s’élève à plus de 250.000, et la moitié de la population a été déplacée; des flots de réfugiés ont rejoint les pays voisins ou l’Union européenne.
Ainsi le conflit syrien a-t-il, à lui seul, inversé les statistiques des conflits mondiaux, et la trajectoire ascendante devient de plus en plus nette si l’on y inclut les victimes de la guerre en Irak, au Yémen et en Libye.
Ceux qui voici cinq ans saluaient le printemps arabe doivent aujourd’hui reconnaître que ses bourgeons ont vite fané. Seule la Tunisie peut afficher un bilan raisonnablement démocratique, tandis que la Libye, le Yémen et la Syrie ont retrouvé la Somalie dans la cohorte des États faillis, et que l’Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, est retourné à l’autocratie, sinon à la dictature.
Quand la tendance, si toutefois une décrue est possible, s’inversera-t-elle à nouveau ? Grâce, pour beaucoup, aux organes multilatéraux comme les Nations-unies, les États ne déclarent que très rarement la guerre à d’autres États (la courte guerre russo-géorgienne, en 2008, est à cet égard l’exception qui confirme la règle).
De même, grâce à l’Union européenne, récompensée du prix Nobel en 2012 pour avoir «contribué, depuis plus de soixante ans, aux progrès de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits humains en Europe», une nouvelle guerre franco-allemande est inconcevable.
En revanche, des guerres ont lieu entre des États et des acteurs non-étatiques, par exemple entre le Nigeria et Boko Haram, ou entre l’Inde et les rebelles naxalites. Comme ont lieu des guerres civiles, par exemple au Soudan du Sud ou en Libye, ou des conflits par procurations, rappelant ceux de la guerre froide, témoin le déploiement par l’Iran de combattants du Hezbollah libanais en Syrie pour défendre le régime de Bachar Al-Assad.
Quelles que soient les causes des conflits, qui se chevauchent souvent – idéologie, religion, affirmation ethnique, compétition pour le contrôle des ressources –, c’est le général prussien Karl von Clausewitz qui en a donné, voici deux siècles, la définition la plus concise: «La guerre est un acte de violence destiné à contraindre notre adversaire à exercer notre volonté».
Mais la force peut-elle à elle seule contraindre l’État islamique à la reddition et faire disparaître du monde musulman l’extrémisme djihadiste ? Il y a deux raisons d’en douter.
La première tient à la réticence des grandes puissances militaires, qu’il s’agisse des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN ou de la Russie de Vladimir Poutine, à envoyer des troupes au sol, après les pénibles expérience d’Irak et d’Afghanistan (qui fut un désastre, dans les années quatre-vingt, pour l’Union soviétique et, au début de ce siècle, pour les États-Unis et l’OTAN).
La seconde raison tient à l’attrait structurel qu’exerce le message islamiste sur de nombreux récepteurs potentiels parmi un milliard trois cent mille musulmans.
Les États-nations du monde arabe sont des inventions coloniales, venues remplacer la succession des califats– omeyyade, abbasside, fatimide et enfin ottoman – qui avaient autrefois étendu la civilisation de la Mésopotamie aux rives de l’Atlantique.
Lorsqu’en juin 2014, Abou Bakr Al-Baghdadi a proclamé un nouveau califat, se désignant lui-même comme «commandeur des croyants», il a touché une corde sensible.
Par ailleurs, la brutalité de son État islamique fondamentaliste ne semble pas tellement différente, aux yeux de beaucoup, du comportement de l’Arabie saoudite, qui durant des décennies a répandu le fondamentalisme wahhabite dans les mosquées et les madrasas qu’elle soutient de par le monde.
Traduction François Boisivon
Copyright: Project Syndicate, 2016.
www.project-syndicate.org
La paix sur le monde musulman
Pour que la paix puisse revenir sur le monde musulman, le message doit changer. Ce qui n’est guère probable à brève échéance. L’Arabie saoudite devra d’abord tempérer son antipathie à l’égard des musulmans chiites en général et de l’Iran à majorité chiite en particulier. Alors même que l’État islamique dispose d’effectifs, d’argent, d’un territoire et d’une expertise militaire acquise pour une bonne part auprès d’anciens officiers de l’armée irakienne.
L’Arabie saoudite reconnaîtra un jour qu’elle a besoin de l’Iran pour vaincre l’État islamique, qui un jour explosera, lorsque les gens finiront par exiger le droit d’écouter de la musique et de pouvoir se conduire comme bon leur semble.
Un jour, certes, mais quand ? Le réflexe de l’Arabie saoudite, né d’une antipathie pluriséculaire entre Arabes et Persans, est encore de voir l’Iran comme une menace à laquelle il faut faire face plutôt que de le considérer comme un voisin qu’il faut tenter de se concilier.
Quant à l’État islamique, l’existence de la Corée du Nord suffit à prouver qu’un régime, pour être brutal, n’en est pas moins éventuellement durable. D’ici là, les statistiques des morts dus aux conflits continueront de grimper, ridiculisant les efforts des diplomates et des négociateurs, bafouant les prétentions à l’humanité et à la civilisation.